Les noms des cinq futures stations enfin dévoilés
Les cinq noms retenus reflètent une volonté de célébrer la diversité, la mémoire collective et les valeurs partagées de Montréal et de son métro.
Rompant avec la tradition de nommer les stations selon les axes routiers adjacents, les noms des futures stations de la ligne bleue honorent des communautés ayant marqué l’histoire de la métropole, tout en soulignant la contribution déterminante de certaines femmes à l’essor social, culturel et économique du Québec.

La station Pie-IX devient Vertières

Le nom Vertières fait référence au lieu d’une bataille fondamentale dans l’indépendance du peuple haïtien. C’est à l’issue de la bataille de Vertières qu’Haïti devient la première république noire au monde, en 1804. Le choix du nom Vertières pour désigner la station de métro située à l’angle de Jean-Talon et Pie-IX rappelle la présence de la communauté haïtienne dans les quartiers Saint-Michel et Montréal-Nord.
Écoutez la voix du métro prononcer le nom Vertières
La station Viau devient Mary-Two-Axe-Earley
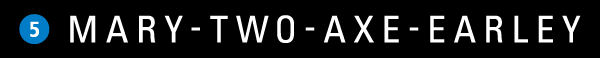
Née à Kahnawake en 1911, Mary Two-Axe Earley est une militante mohawk ayant lutté activement pour la reconnaissance des droits des femmes et des enfants autochtones. Son travail acharné permet de mettre fin à la discrimination des femmes mariées à des non-autochtones, par des modifications à la loi. Le choix du nom Mary-Two-Axe-Earley pour désigner la station de métro située à l’angle de Jean-Talon et Viau vise à reconnaitre l’héritage de cette pionnière inspirante.
Écoutez la voix du métro prononcer le nom Mary-Two-Axe-Earley
La station Lacordaire devient Césira-Parisotto

Née en 1909 en Italie, Césira Parisotto, également connue sous le nom de Mère Anselme, a voué sa vie aux œuvres de bienfaisance au sein de la communauté des Sœurs de Charité de Sainte-Marie. Elle a fondé plusieurs institutions, dont l’École Marie-Clarac et l'Hôpital Marie-Clarac. Le choix du nom Césira-Parisotto pour désigner la station de métro située à l’angle de Jean-Talon et Lacordaire évoque la présence de la communauté italienne dans l’arrondissement de Saint-Léonard.
Écoutez la voix du métro prononcer le nom Césira-Parisotto
La station Langelier devient Madeleine-Parent

Née en 1918, la militante et syndicaliste Madeleine Parent s’est distinguée par son engagement social et ses convictions profondes. Elle consacre sa carrière à l'amélioration des conditions de vie des femmes de toutes origines culturelles, dont les femmes autochtones et immigrantes. Elle défend avec ardeur l’équité salariale et se bat pour les droits des plus démunis. Le choix du nom Madeleine-Parent pour désigner la station de métro située à l’angle de Jean-Talon et Langelier souligne le legs important de cette figure de proue du mouvement féministe.
Écoutez la voix du métro prononcer le nom Madeleine-Parent
La station terminale s'appelle Anjou

Le nom Anjou fait bien entendu référence à l’arrondissement du même nom. De 1956 à 2002, soit avant les réorganisations municipales québécoises, Anjou a aussi été une municipalité. Le toponyme Anjou fait allusion à une ancienne province de France d’où provient un nombre important de pionniers de la Nouvelle-France. Le nom Anjou pour la station terminale du prolongement de la ligne bleue s’est imposé pour faciliter l’orientation géographique de la clientèle.
Écoutez la voix du métro prononcer le nom Anjou
La réflexion au sujet des noms de nos cinq futures stations est le fruit d’un processus complexe et rigoureux.
Un comité de toponymie a été mis sur pieds il y a quelques années. Ce comité a dégagé les orientations guidant la sélection des noms et débattu de multiples propositions. Il était composé de représentants de la STM, d’élus municipaux, de représentants des arrondissements, de spécialistes en histoire, en toponymie et en urbanisme, ainsi que de représentants de groupes culturels (Conseil interculturel de Montréal, Conseil des Montréalaises et Terres en vue).
Les critères de sélection et la variété de représentants impliqués répondent notamment aux recommandations énoncées par les Commissaires, à l’occasion de la consultation publique tenue à l'hiver 2020. Ainsi, le comité a décidé d’accorder une grande place aux femmes dans ses choix et a veillé à mettre en lumière les réalités multiculturelles et autochtones.
De nombreuses suggestions du grand public ont été soumises à l’attention du comité, tandis que la banque de noms Toponym’Elles de la Ville de Montréal a été mise à contribution. Le processus a aussi nécessité des démarches auprès de la Commission de toponymie, de la Ville de Montréal et des autres partenaires du projet. Finalement, nous avons consulté l’entourage des personnes sélectionnées, avant de rendre les noms publics.
Six grandes orientations ont mené aux choix des noms des nouvelles stations :
- Maintenir les noms du réseau actuel : afin d’éviter des coûts supplémentaires, les noms Pie-IX, Viau et Langelier ont été conservés sur la ligne verte.
- Éviter toute confusion pour la clientèle : déjà présents sur la ligne verte, les noms Pie-IX, Viau et Langelier n’ont pas été répétés sur la ligne bleue.
- Choisir des noms évocateurs : au lieu d’utiliser des noms existant déjà à proximité des nouvelles stations, il a été jugé préférable d’utiliser de nouveaux noms, plus évocateurs.
- Éviter les noms problématiques : ont été exclus les noms de personnes vivantes ou décédées depuis moins d'un an, de personnes dont la notoriété est liée à des drames personnels ou susceptibles d'alimenter la dissension, et les noms de nature commerciale.
- Prendre le pouls du milieu : les propositions faites à la STM et dans le cadre de la consultation publique du prolongement ont été transmises aux membres du comité toponymique, qui ont également pris le pouls de leur milieu.
- S’inspirer de la diversité montréalaise : les noms définitifs s’inspirent de l’apport des communautés ethnoculturelles locales, de l’histoire des quartiers d’accueil, de Montréal et du Québec, des peuples autochtones et des femmes.
Le Projet ligne bleue s’inscrit dans la foulée de la Déclaration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour revitaliser l’Est de Montréal. De nombreux projets sont en cours pour donner une nouvelle impulsion à ce secteur. L’accroissement de la mobilité, le développement économique et l’amélioration des milieux de vie des citoyens sont au cœur de cet ambitieux chantier. Pour en savoir plus, consultez Québec.ca/RevitalisationEstMontreal.
